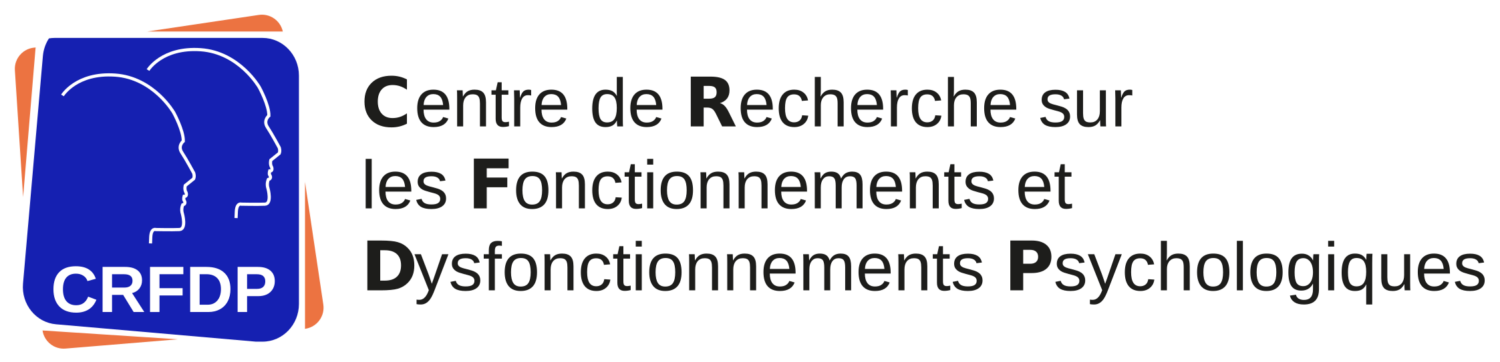4ème Après-midi Recherche CRFDP Masters-Doctorats
Jeudi 3 avril 2025
Salle A102, UFR SHS, Bâtiment Blondel, Campus de Mont-Saint-Aignan, 13h30-16h30
Organisation
Bruno VIVICORSI (maître de conférences en psychologie)
Anne-Laure SORIN (ingénieure d’études au CRFDP)
Ce 4ème après-midi Recherche Masters-Doctorats du laboratoire CRFDP vise à proposer un espace d’informations et d’échanges autour de communications orales présentées par des doctorant.e.s à propos de leur recherche. Les membres permanent.e.s (MCU, MCU-HDR, PU, IGE), temporaires (doctorant.e.s, docteur.e.s, ATER) et associé.e.s du laboratoire ainsi que les étudiant.e.s de M1 et M2 du master de psychologie sont convié.e.s à ces après-midi Recherche faisant liens entre master et doctorat, au sein du CRFDP. Les communications sont de 15 minutes et 15 minutes d’échanges.
Ce 4ème après-midi Recherche Masters-Doctorats fait suite au 3ème après-midi qui s’est déroulé le 28 novembre 2024 avec la présentation de 5 étudiant.e.s de Master2. Que soient ici remercié.e.s les intervenant.e.s et la modératrice de leur participation volontaire. Ces après-midi sont considérés comme des séminaires de recherche du laboratoire CRFDP.
Programme
Modératrice
Noémie PANKRATOFF (doctorante, équipe Vulnérabilité)
13h30 – Être (im)patient, l’accueil en oncologie ambulatoire des patients âgés de 60 à 75 ans atteints d’un cancer de mauvais pronostic : regard croisé patients/ soignants sur la représentation du lieu et du temps d’attente
Juliana VIENNE
Doctorante ATER au CRFDP (UR 7475), Équipe Vulnérabilité
Université Rouen Normandie – Mél : juliana.vienne1@univ-rouen.fr
Le cancer est une problématique majeure de santé publique avec une volonté d’améliorer la qualité de vie des patients par la réduction du temps d’hospitalisation ce qui influe sur l’organisation des soins. Nous nous questionnons si la manière d’accueillir le patient a une incidence sur la représentation du temps et du lieu d’attente en hôpital de jour.
La méthodologie s’appuie sur deux disciplines, la psychologie et la géographie de la santé : un auto-questionnaire, une cartographie mentale et un entretien semi-directif. La recherche inclut des patients adultes atteints d’un cancer du poumon ou du pancréas et les professionnels des deux hôpitaux de jour du CHU de Rouen. Nous avons rencontré 46 participants : 29 patients et 17 professionnels.
Les résultats montrent une satisfaction globale chez les patients pour les soins reçus avec la priorité à la relation humaine. Les professionnels sont satisfaits de leur travail et ils appuient la nécessité d’un accueil par un professionnel avec lieu dédié. Les préconisations s’orientent sur l’amélioration de l’accueil des patients où il s’agit d’envisager autrement l’anticipation de sa prise en charge, de ses soins et de ses déplacements dans l’environnement qui pourrait alors améliorer la relation soignant/ soigné et la qualité de vie des patients.
Encadrants : Jean-Michel COQ, maître de conférences HDR, CRFDP (UR 7475) & Alain VAGUET (UMR IDEES), Université de Rouen Normandie
14h00 – Stigmate et cancer des voies aérodigestives supérieurs (VADS)
Vianney BASTIT
Doctorant au CRFDP (UR 7475), Équipe Investigation, Intervention, Changement : du psychologique au sociétal
Université Rouen Normandie – Mél : vianney.bastit1@univ-rouen.fr
Le stigmate peut se définir comme la relation entre un attribut et un stéréotype, impliquant alors des phénomènes de rejet ou de discrimination (Goffman, 1963). Comme d’autres maladies, le cancer fait l’objet de stigmatisations (Pachankis, 2018).
Selon le modèle de Weiner et al. (1988), ou processus d’attribution causale, la cause perçue d’un stigmate va déterminer les réactions affectives et donc les manifestations comportementales du stigmate. Jones et al. (1984) ont par ailleurs décrit 6 dimensions permettant de caractériser l’attribut stigmatisant.
Il est facile d’imaginer qu’au sein de la pluralité des cancers et de leurs causes présupposées, les caractéristiques du stigmate puissent varier. Notre hypothèse est que le cancer des VADS (compte tenu des facteurs de risque « habituellement » associés – alcool, tabac, HPV) est perçu comme hautement contrôlable en comparaison à d’autres cancers, suscitant ainsi une plus forte stigmatisation publique et auto-stigmatisation (Pryor & Reeder, 2011).
Il n’existe pas à notre connaissance d’étude spécifique comparative de la représentation entre les différents types de cancer et leurs causes. Nous proposons à l’issue d’une revue systématique de la littérature, de réaliser auprès de la population générale, une cartographie des représentations mentales des différents cancers à partir du modèle de Jones.
Encadrants : Benoît MONTALAN, maître de conférences HDR, CRFDP (UR 7475), Université de Rouen Normandie & Emmanuel BABIN, PU-PH (CERREV) Université de Caen Normandie, CHU Caen Normandie
14h30 – Freins et leviers au maintien à domicile pour des personnes présentant un handicap moteur sévère : l’exemple de la région mancelle
Anne-Claire HUARD
Doctorante au Pôle régional du Handicap (CIFRE), CRFDP (UR 7475), Équipe Vulnérabilité
Université Rouen Normandie – Mél : anne-claire.huard@univ-rouen.fr
En France, bien que les dispositifs publics et législatifs s’alignent sur le nouveau modèle social du handicap (CDPH, 2008), l’accès à un domicile reste encore limité pour les personnes avec des incapacités motrices majeures. Pourtant, le domicile représente un espace identitaire nécessaire à l’équilibre psychique (Maraquin, 2015). La recherche présentée évalue les freins et les leviers au maintien à domicile des personnes handicapées sévèrement sur le plan moteur. À partir d’une méthode participative ancrée dans le territoire sarthois, nous avons bénéficié du dispositif CIFRE en partenariat avec le Pôle régional du Handicap, association œuvrant auprès de personnes avec un handicap moteur sévère (e.g., traumatisme crânien, AVC, paralysie cérébrale, sclérose en plaques…). Nous avons utilisé une méthode mixte mobilisant l’apport de 50 entretiens (personnes concernées, familles, professionnels…), de 66 questionnaires (WHOQOL-BREF, 1996 ; BPNFS, 2021), ainsi que 3 observations réalisées à domicile (aides à domicile, personnes concernées).
Mots-clés : Domicile – Handicap moteur – Aides à domicile – Aidants – Habitat inclusif
Encadrantes : Anne BOISSEL, maître de conférences HDR & Virginie ALTHAUS, maîtresse de conférences, CRFDP (UR 7475), Université Rouen Normandie
15h – Traduction française de la très courte échelle de l’autoritarisme de Bizumic et Duckitt
Tanya BERSOULT & Kylian DUCHEMIN
Doctorant·e·s au CRFDP (UR 7475), Équipe Vulnérabilité
Université Rouen Normandie – Méls : tanya.bersoult@gmail.com, kylian.duchemin@univ-rouen.fr
Depuis sa conception par Altemeyer (1981), l’autoritarisme de droite (Right Wing Authoritarianism) est un prédicteur essentiel dans l’étude des comportement et attitudes sociales (cf. Heaven et al., 2011; De Keersmaecker et al., 2017). Ainsi, de nombreux travaux visant à réviser l’échelle originale, en tester les dimensions et réduire sa durée de passation ont pu voir le jour (Zakrisson, 2005 ; Bizumic & Duckitt, 2018…). Toutefois, bien que cette échelle ait été utilisée dans la recherche francophone (e.g., Bret, 2018), aucune traduction, adaptation et validation française n’a encore été menée à ce jour.
En suivant les guides des pratiques recommandées par Vallerand (1989), l’International Test Commission (2017) et Gana et al. (2021), cette présentation propose une méthodologie de traduction en six étapes de la très courte échelle de l’autoritarisme de Bizumic et Duckitt (2018). Cette méthodologie explicite les particularités du travail d’adaptation culturel qui empêchent une traduction littérale, complexifient la validation concomitante et la confirmation de la structure factorielle de la nouvelle échelle. Enfin, la présentation inclut les résultats préliminaires de l’application des quatre premières étapes.
Encadrante : Odile CAMUS, maître de conférences HDR, CRFDP (UR 7475), Université Rouen Normandie
Références
Altemeyer, B. (1981). Right-Wing Authoritarianism. University of Manitoba Press.
Bizumic, B., & Duckitt, J. (2018). Investigating Right Wing Authoritarianism With a Very Short Authoritarianism Scale. Journal of Social and Political Psychology, 6(1), Article 1.
https://doi.org/10.5964/jspp.v6i1.835
Bret, A. (2018). Autoritarisme de droite et changement d’attitude dans le conditionnement évaluatif [Thèse de doctorat, Université Grenoble Alpes]. https://theses.hal.science/tel-02391765
De Keersmaecker, J., Roets, A., Dhont, K., Van Assche, J., Onraet, E., & Van Hiel, A. (2017). Need for Closure and Perceived Threat as Bases of Right-Wing Authoritarianism : A Longitudinal Moderation Approach. Social Cognition, 35(4), 433‑449. https://doi.org/10.1521/soco.2017.35.4.433
Gana, K., Boudouda, N.E., Ben Youssef, S., Calcagni, N., & Broc, G. (2021). Adaptation transculturelle de tests et échelles de mesure psychologiques : guide pratique basé sur les Recommandations de la Commission Internationale des Tests et les Standards de pratique du testing de l’APA. Pratiques Psychologiques, 27(3), 223‑240. https://doi.org/10.1016/j.prps.2021.02.001
Heaven, P.C.L., Ciarrochi, J., & Leeson, P. (2011). Cognitive ability, right-wing authoritarianism, and social dominance orientation : A five-year longitudinal study amongst adolescents. Intelligence, 39(1), 15‑21. https://doi.org/10.1016/j.intell.2010.12.001
International Test Commission. (2017). The ITC Guidelines for Translating and Adapting Tests (Second Edition). www.InTestCom.org
Vallerand, R. J. (1989). Vers une méthodologie de validation trans-culturelle de questionnaires psychologiques : Implications pour la recherche en langue française. [Toward a methodology for the transcultural validation of psychological questionnaires: Implications for research in the French language.]. Canadian Psychology / Psychologie canadienne, 30(4), 662‑680.
https://doi.org/10.1037/h0079856
Zakrisson, I. (2005). Construction of a short version of the Right-Wing Authoritarianism (RWA) scale. Personality and Individual Differences, 39(5), 863‑872. https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.02.026
15h30 – Exploration des antécédents de traumatisme crânien dans le récit de vie des femmes incarcérées – phase exploratoire à la maison d’arrêt de Versailles
Marine DARTOIS
Doctorante au CRFDP (UR 7475), Équipe Vulnérabilité
Université Rouen Normandie – Mél : marine.dartois1@univ-rouen.fr
En France, les femmes représentent 3,3% de la population carcérale globale au 1er janvier 2021. Les conséquences des traumatismes crâniens sur la population carcérale sont explorées depuis plusieurs années chez les hommes, mais pas chez les femmes. À notre connaissance, aucune étude qualitative sur le parcours de vie et le récit de l’accident ayant donné lieu au choc cérébral n’existe chez elles. Face à ce manque de connaissances, cette recherche adopte une approche qualitative basée sur les récits de vie des femmes incarcérées. La recherche vise à explorer les liens entre les antécédents de traumatisme crânien, et leurs conséquences, notamment les changements dans le contrôle des affects et des comportements, et le parcours pénal et judiciaire des femmes incarcérées à travers leur vécu. Durant la phase exploratoire, les participantes de la maison d’arrêt de Versailles prendront part à un entretien libre sur leur parcours de vie, qui fera l’objet d’une analyse thématique. Elles seront également sollicitées afin de compléter l’échelle NRS-R permettant d’évaluer les troubles cognitifs et du comportement chez une personne ayant subi un traumatisme crânien. Une hétéroévaluation des changements liés au traumatisme crânien dans la vie quotidienne sera proposée à l’entourage des détenues participantes. Encadrant·e·s : Anne BOISSEL, maître de conférences HDR, CRFDP (UR 7475) & Éric VERIN, PUPH, GRHVN (UR3830), Université de Rouen Normandie